
À lire sur Slate.fr
Stress tests, mes fesses!
par Philippe Reclus

que la gouvernance économique, les stratégies fiscales ou la politique
budgétaire. Rien d'étonnant à voir que l'Europe peine, comparée aux
Etats-Unis, à convaincre sur l'état réel de son système bancaire.
Seules 7 banques ne résistent pas au stress test
En cette période où la «société de défiance» n'a jamais aussi bien portéson nom, l'exercice du «je vous dis tout» auquel tout ce qui compte
dans la banque européenne vient de se prêter avait pour ambition de
fournir un supplément de confiance qui manque tant.
A fortiori, le but devrait être atteint: les tests de résistance qui ont
passé à la moulinette les portefeuilles d'actifs financiers, de
financements de l'immobilier, de prêts aux entreprises et de crédits
interbancaires de 91 banques de 20 pays européens ainsi que leur
sensibilité à la volatilité des taux d'intérêt et aux risques de crédit,
ont abouti à un score quasi stalinien: seules 7 banques ont été
recalées et déclarées inaptes à affronter une nouvelle tempête.
Et l'identité de ces banques ne provoque pas, au regard de la géographie
de la crise, de profonde surprise: cinq banques espagnoles, dont on
sait que l'économie paie un lourd tribut à la spéculation immobilière,
une banque grecque (c'est peu compte tenu de l'état de l'économie
hélène), et une allemande (la Hypo Real Estate réputée depuis des mois
comme l'homme malade de la banque germanique) ont échoué.
Aucune banque britannique (il est vrai, elles ont été nationalisées en
partie). Quant aux françaises, elles ont non seulement déjà rendu
l'argent prêté par l'Etat pour la majorité d'entre elles, mais, en cas
de nouvelle crise, BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole et
BPCE, verraient leur ratio de solvabilité cumulé, c'est à dire la part
de fonds propres rapportée à leurs engagements, revenir à 9,3 % fin
2011, contre 9,9 % fin 2009 (à comparer à un minimum de 6% exigé).
Quelques applaudissements polis
Alors quoi? On est loin, très très loin des chiffres évoqués cesdernières semaines par les bureaux d'analyse sur le montant réel des
besoins en fonds propres supplémentaires des banques européennes. A
peine 3, 5 milliards d'euros seraient nécessaires. C'est moins de 10% du
montant calculé par les Cassandre les plus prudents, et à une distance
stratosphérique des 80 à 90 milliards d'euros que certains bureaux
anglo-saxons n'hésitaient pas à chiffrer. Ainsi, pour les seules banques
espagnoles, les analystes de la Royal Bank of Scotland estimaient le
besoin de recapitalisation à 50 milliards d'euros!
Enfin, certains diront qu'on est très loin des 75 milliards de dollars
que les banques américaines ont dû lever après le même type de tests au
printemps 2009 sachant toutefois qu'on était à l'époque en pleine crise
et qu'entretemps, les banques européennes ont été déjà renflouées (de
220 milliards d'euros). La comparaison paraît donc peu pertinente.
On aurait donc dû s'attendre à une «standing ovation» des marchés au
lendemain de ces annonces. Tout juste a-t-on observé ici quelques
applaudissements polis, là un enthousiasme précautionneux ou là encore
un discret satisfecit.
Pourquoi un tel accueil?
Cette modération peut avoir plusieurs explications.1. Les marchés avaient déjà anticipé ces résultats rassurants.
2. Tout le monde reste sur sa faim, considérant que les tests n'ont pas
été suffisamment sévères pour fournir une photo fidèle de la situation. A
ce titre, le périmètre d'actifs à risque retenu n'aurait pas été assez
large, les superviseurs européens écartant dans leurs scénarios de crise
celui provoqué par la faillite d'un ou de plusieurs Etats européens
dont les banques détiennent des masses d'emprunts publics.
Or le risque de la faillite d'un Etat au sein de la zone euro figure bien au cœur des préoccupations du marché.
3. Si une forte majorité de banques européennes passent avec succès
l'examen, bon nombre restent «ric-rac». Ainsi, en cas de crise, dix-sept
établissements, et non des moindres (Deutsche Bank, Allied Irish Bank,
Monte dei Paschi di Sienna et une ribambelle de banques espagnoles)
afficheraient des ratios de solvabilité entre 6 et 7%, soit le minimum.
On aurait tout de même de quoi s'étonner de la différence d'accueil —entre le franc soulagement outre-Atlantique et le ouf parcimonieux ici—
qu'à un an et demi d'intervalle les marchés ont réservé à ce type
d'opération vérité bancaire. Au jeu des relations publiques, l'Amérique
aurait donc encore beaucoup de leçons à donner à l'Europe.
Là encore, les tentatives d'explication ne manquent pas. A tirer les
premiers, et le plus vite, les Américains ont pu, d'une certaine
manière, faire dire ce qu'ils voulaient aux tests, ce qui leur avait
permis de rebondir en Bourse et de dissiper les doutes après avoir levé
75 milliards de dollars. Sur 19 banques mises à l'épreuve, 10 avaient dû
faire appel au marché.
Un an et demi plus tard, les Européens réitèrent l'exercice et peinent à
convaincre et rassurer complètement en dépit des assauts de
transparence.
La démarche européenne réclamerait, aux dires de ses défenseurs, plus de
temps pour être appréciée à son juste niveau. «Cherchez et vous
trouverez», semble-t-elle dire aux analystes financiers, à qui ont été
fournis —pourvu qu'ils se donnent la peine d'examiner les détails—
tous les chiffres nécessaires pour évaluer l'exposition de chaque banque
(excepté les banques allemandes) au risque souverain de chaque pays et
bâtir leurs simulations. Qu'ils trient!
Les Européens dispersés
Alors, ces tests sont-ils crédibles ou non? Telle n'est peut être pas la bonne question à se poser. La différenced'impact entre les opérations vérité menées par les Etats-Unis et
l'Europe tient sans doute plus, il faut une fois encore le souligner, au
manque de cohérence de la construction européenne. Au même titre que le
vieux continent ne parvient pas à parler d'une seule voix en matière de
politique et de gouvernance économiques, de stratégie budgétaire ou
fiscale, il est logiquement condamné aussi à laisser le leadership au
grand partenaire américain en matière de règles comptables, de normes
prudentielles et de méthodes d'évaluation des risques. Comme
l'approbation du budget, la fixation du taux de l'impôt et la gestion de
la dette, l'évaluation des engagements souverains de ses banques
constituent des éléments fondamentaux de souveraineté nationale. Au même
titre d'ailleurs que la supervision et le contrôle des banques.
L'Amérique parle d'une seule voix. Les Européens restent dispersés. Difficile, de ce point de vue, d'imaginer que lors de la prochaine
bataille sur la définition des règles comptables bancaires et la
fixation d'un matelas minimum de fonds propres concoctée à Bâle, les
choses auront changé.
Philippe Reclus
Photo: Démonstration de Stress Test à Union Station/ Wikicommons
Lire l'article original sur Slate.fr
Liens:
[1] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dianetics_demo_at_Union_Station.jpg
[2] http://www.slate.fr/source/philippe-reclus
[3] http://www.slate.fr/story/17101/comment-les-grandes-banques-americaines-ont-failli-nous-ruiner
[1] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dianetics_demo_at_Union_Station.jpg
[2] http://www.slate.fr/source/philippe-reclus
[3] http://www.slate.fr/story/17101/comment-les-grandes-banques-americaines-ont-failli-nous-ruiner



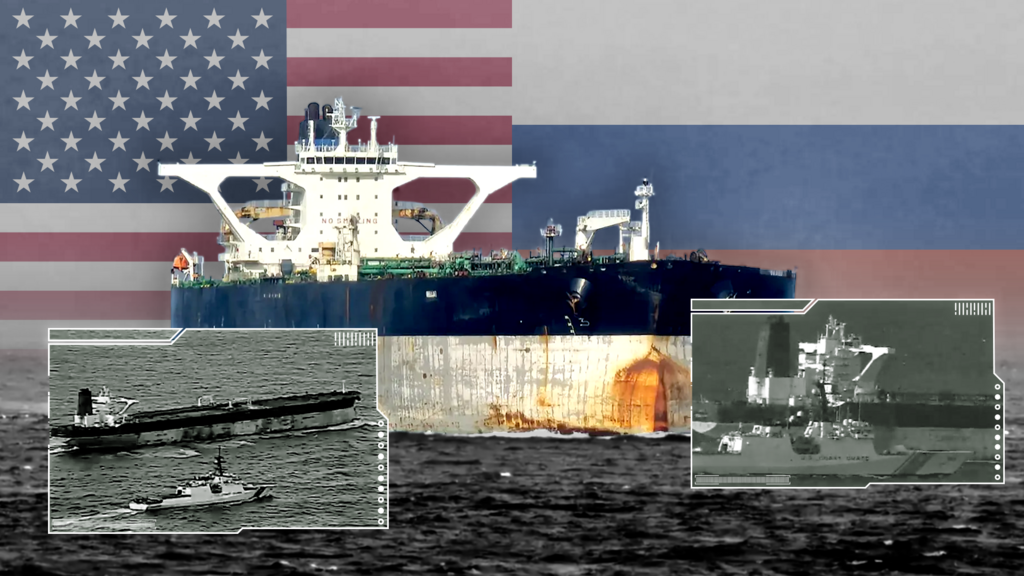
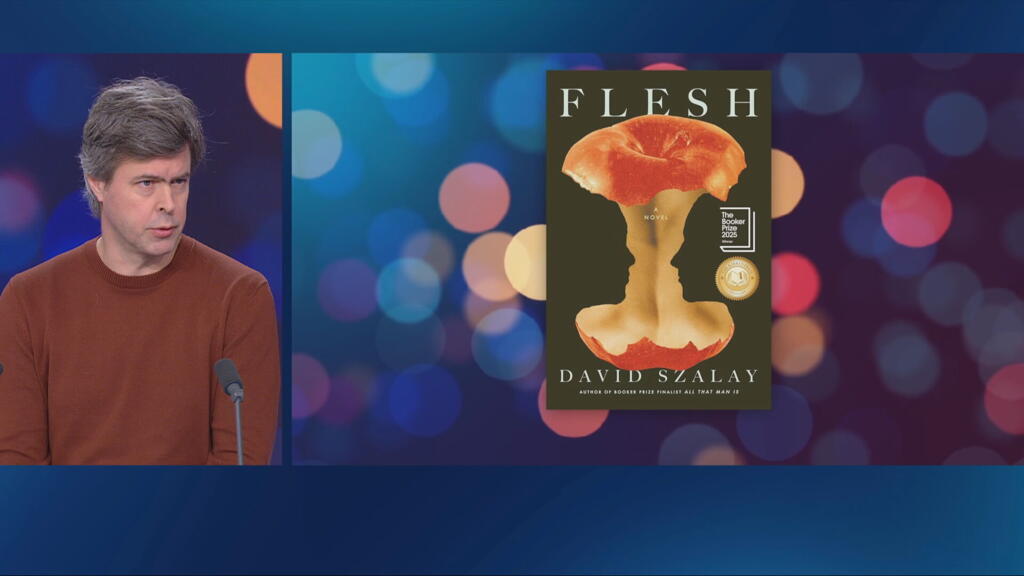




































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire